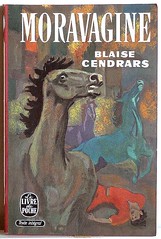Cher Kenneth,
Comme j'ai parlé de toi il y a peu, parce qu'en fait je t'avais vu à la télé tout simplement, il me revient en mémoire depuis plusieurs jours nombre de scènes de l'extraordinaire Beaucoup de bruit pour rien. Et notamment la paisible ouverte sur l'air de Tra, déri, déra. Insouciance. Et lumineuse Emma Thompson qui parle comme on dévore, avec gourmandise et des étoiles dans les yeux.
L'ouverture ensuite, grandiose, avec les héros chevauchant au ralenti, Denzel, Kenneth, Robert Sean, Keanu... Et puis tellement d'autres moments. Bien sûr, il faut aimer les dialogues, car les joutes oratoires que se livrent Benedict-Branagh et Béatrice-Thompson sont comme du miel... qu'ils se jetteraient à la figure. Tout coule, sonne bien, retentit ou s'engloutit selon l'humeur, la musique des mots chez Shakespeare est incroyable. Il y a vraiment quelque chose de jouissif dans son phrasé qui transporte. Enfin, je ne vais pas redécouvrir l'eau tiède mais tout de même, quel rythme ! Toutefois, pour avoir vu et revu et re-revu les versions française et anglaise je peux te dire mon cher Kenneth que les bouffeurs de grenouilles ont bien fait leur taf.
Pour autant, la rythmique en anglais est sans pareille. Et même si l'ancien Charlot Gérard Rinaldi double excellemment l'halluciné Michael Keaton, on ne doit pas passer à côté de sa prestation majuscule en V.O.
La parenthèse complètement déjanté que constitue l'apparition du connétable Dogberry et de ses acolytes idiots ne doit pas faire oublier l'excellent marivaudage qui est la base du film et de la pièce, deux histoires d'amour, l'une toute tracée entre Hero et Claudio, mais contrariée par le méchant Dom John, l'autre impensable mais arrangée, entre Bénédict et Béatrice.
Le casting est énorme, mais personne ne marche sur les pieds de ses partenaires et tous les seconds rôles peuvent se hisser au même rang que les premiers, je pense notamment à la bonhommie de Richard Briers en Leonato ou les gloussements viveurs d'Imelda Staunton en Margaret, que tu recroiseras (ou presque) chez Harry Potter en Dolores Umbridge. Chez Shakespeare, plus encore même que chez Molière, les seconds rôles sont essentiels et se taillent une part de choix.
Kenneth, je n'ai pas vu toutes tes adaptations de Shakespeare mais l'Indien que je suis a pleuré comme un veau devant Henry V et la tirade de la saint-Crépin, ri aux algarades faussement désintéressées entre Benedict et Béatrice, célibataires endurcis et libres penseurs...
Vraiment quel bon moment. Et quellle musique. Et quelle lumière. Rien que pour la lumière de Beaucoup de Bruit pour Rien, tu devrais être remercié.
Merci Kenneth.
Amicalement,
Hrundy V.
mercredi 25 septembre 2013
lundi 16 septembre 2013
Meurtriers sans visage
Cher Henning,
Ce qu'il y a de bien avec les histoires d'amour littéraire, c'est que les entremetteurs sont nombreux sur le web. J'avoue que je ne te connaissais ni d'Eve ni d'Adam il y a quelques mois et puis, un jour, me demandant si j'étais bien sûr d'avoir bien lu tous les Fred Vargas, je suis tombé sur un forum où un lecteur vous comparait. En substance, c'était "si vous aimez Adamsberg, vous aimerez Wallander."
Erreur grave, comme disait l'autre.
Parce que oui c'est vrai, Wallander et Adamsberg ont effectivement des points communs. Plein en fait. Ils sont décalés, chacun à leur manière, à la fois à la limite de la misanthropie et pleins de compassion, pas très heureux en amour mais pas sans succès non plus, ils sont régulièrement en difficulté avec la hiérarchie sans pourtant être des va-t-en-guerre... Bref, ils sont humains, ils subissent aussi bien leur vie que toi ou moi. Enfin surtout toi parce que moi j'assure grave. Bref. Je reviens à mon erreur.
J'aime bien Adamsberg. J'aime bien Wallander. Mais les styles de vos écrits à Fred et toi sont bien différents. Son univers à elle est riche de culture, de références, tout est construit et magnifié, on se sent, on sait dans un monde parallèle. Chez toi, et ça m'a choqué, vraiment, tout est aride, sec, rude. Ton univers est parfaitement réel et triste et morne. Dans meurtriers sans visage, rien ne dépasse. Jusqu'à l'intrigue, qui est parfaitement inutile. Un couple de vieux a priori sans histoire se fait torturer et buter dans la cambrousse suédoise. Avant de rendre son dernier souffle, la vieille a le temps de répéter le mot "étranger" à un inspecteur. Et à la fin, paf, ce sont bien des étrangers, venant de nulle part, qui ont fait le coup. A la fois, c'est frustrant et jouissif. Voilà une enquête fastidieuse, longue, complexe mais dont le lecteur, pas plus que l'enquêteur, ne maîtrise le moindre début de petit fil.
On s'enlise avec Wallander parce que tout simplement il ne possède aucun indice et nous non plus. Et le récit ne se construit pas vraiment autour du mystère, mais bien autour du travail et de la vie quotidiens de ce serviteur de la loi (pas vraiment) comme les autres. Il galère, il souffre, il s'accroche, il doute, il envoie chier, et avec lui on souffre... mais on reste. Parce que ma foi, le verbe est clair, calibré, aisé à lire. Parce qu'on se reconnait dans les loupés, les doutes, les petites lâchetés du quotidien. Meurtriers sans visage est plus une chronique du quotidien qu'un vrai policier à mon sens. Et plus j'y repense et plus j'en suis content.
Je suis content aussi d'avoir commencé par le premier de la série des Wallander, puisque j'ai appris plus tard que c'est une vraie série, avec un héros qui évolue, et qui va même changer pour de bon. Du coup je vais aller chercher le 2e... Et puis, ô surprise, étonnement, et même - dirais-je paraphrasant le grand maître Maître - gaspation ! voilà-t-y pas qu'hier soir, en ouvrant mon poste pour me rendre compte que j'avais raté Jean-Claude Bourret, je tombe sur l'extraordinaire Kenneth Brannagh, que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois, ni tout à fait le même... ce bon Kenneth disais-je, dans les habits froissés et à l'hygiène douteuse de Kurt le suédois. Je savais que j'avais eu raison de te lire.
Je vais donc aussi te regarder. "Alea jacta est" dit-il, les pieds boueux de les avoir trempés dans le ru.
Merci Henning.
Amicalement, Hrundy V.
Ce qu'il y a de bien avec les histoires d'amour littéraire, c'est que les entremetteurs sont nombreux sur le web. J'avoue que je ne te connaissais ni d'Eve ni d'Adam il y a quelques mois et puis, un jour, me demandant si j'étais bien sûr d'avoir bien lu tous les Fred Vargas, je suis tombé sur un forum où un lecteur vous comparait. En substance, c'était "si vous aimez Adamsberg, vous aimerez Wallander."
Erreur grave, comme disait l'autre.
Parce que oui c'est vrai, Wallander et Adamsberg ont effectivement des points communs. Plein en fait. Ils sont décalés, chacun à leur manière, à la fois à la limite de la misanthropie et pleins de compassion, pas très heureux en amour mais pas sans succès non plus, ils sont régulièrement en difficulté avec la hiérarchie sans pourtant être des va-t-en-guerre... Bref, ils sont humains, ils subissent aussi bien leur vie que toi ou moi. Enfin surtout toi parce que moi j'assure grave. Bref. Je reviens à mon erreur.
J'aime bien Adamsberg. J'aime bien Wallander. Mais les styles de vos écrits à Fred et toi sont bien différents. Son univers à elle est riche de culture, de références, tout est construit et magnifié, on se sent, on sait dans un monde parallèle. Chez toi, et ça m'a choqué, vraiment, tout est aride, sec, rude. Ton univers est parfaitement réel et triste et morne. Dans meurtriers sans visage, rien ne dépasse. Jusqu'à l'intrigue, qui est parfaitement inutile. Un couple de vieux a priori sans histoire se fait torturer et buter dans la cambrousse suédoise. Avant de rendre son dernier souffle, la vieille a le temps de répéter le mot "étranger" à un inspecteur. Et à la fin, paf, ce sont bien des étrangers, venant de nulle part, qui ont fait le coup. A la fois, c'est frustrant et jouissif. Voilà une enquête fastidieuse, longue, complexe mais dont le lecteur, pas plus que l'enquêteur, ne maîtrise le moindre début de petit fil.
On s'enlise avec Wallander parce que tout simplement il ne possède aucun indice et nous non plus. Et le récit ne se construit pas vraiment autour du mystère, mais bien autour du travail et de la vie quotidiens de ce serviteur de la loi (pas vraiment) comme les autres. Il galère, il souffre, il s'accroche, il doute, il envoie chier, et avec lui on souffre... mais on reste. Parce que ma foi, le verbe est clair, calibré, aisé à lire. Parce qu'on se reconnait dans les loupés, les doutes, les petites lâchetés du quotidien. Meurtriers sans visage est plus une chronique du quotidien qu'un vrai policier à mon sens. Et plus j'y repense et plus j'en suis content.
Je suis content aussi d'avoir commencé par le premier de la série des Wallander, puisque j'ai appris plus tard que c'est une vraie série, avec un héros qui évolue, et qui va même changer pour de bon. Du coup je vais aller chercher le 2e... Et puis, ô surprise, étonnement, et même - dirais-je paraphrasant le grand maître Maître - gaspation ! voilà-t-y pas qu'hier soir, en ouvrant mon poste pour me rendre compte que j'avais raté Jean-Claude Bourret, je tombe sur l'extraordinaire Kenneth Brannagh, que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois, ni tout à fait le même... ce bon Kenneth disais-je, dans les habits froissés et à l'hygiène douteuse de Kurt le suédois. Je savais que j'avais eu raison de te lire.
Je vais donc aussi te regarder. "Alea jacta est" dit-il, les pieds boueux de les avoir trempés dans le ru.
Merci Henning.
Amicalement, Hrundy V.
Libellés :
Fred Vargas,
Henning Mankell,
Jean-Baptiste Adamsberg,
Jean-Claude Bourret,
Kenneth Brannagh,
Kurt Wallander,
lecture,
Maester,
Meurtriers sans visage,
policier,
roman,
Suède
dimanche 15 septembre 2013
Charly 9
Cher Jean,
J'ai l'impression de te connaître depuis toujours.
Je recommence. En réalité, je te connais depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression diffuse que tu as foutu ta grande carcasse dans RécréA2 à un moment ou à un autre. Il y a eu bien sûr l'Echo, et Nulle part Ailleurs. Ta voix, je la connais. Ton style, je le connais. Ta gueule aussi je la connais, et c'est pas que parce que ton pote Edika te met en scène une eux fois dans Fluide. Y a autre chose. Je trouverai, nom de Zeus, je trouverai.
Tes mots en revanche, je les ai découverts tard, il y a une dizaine d'année, avec Rainbow pour Rimbaud, une belle histoire d'amour décalée qui part de Charleville-Mézières pour faire le tour du monde... Ton Je, François Villon était clair, simple, brillant et horrifiant. Je l'avais adoré, il m'avait dévoré.
Et puis cet été, puisque je me suis remis à lire, je me suis très naturellement plongé dans Charly 9, sans savoir dans quoi je m'aventurais.
Il est rassurant de se rendre compte que certaines bonnes choses ne changent pas. Ton style, fluide, rapide, agréable. Tes chapitres courts et nerveux. Tes dialogues, parfaitement huilés. L'humanité de tes personnages, surtout, leur ombre et leur lumière mélangées sans que jamais le flou ne s'installe. Et pourtant ça part sévère.
Premier chapitre, Catherine de Médicis sa mère, le duc d'Anjou son frère et l'ensemble de son conseil se liguent pour le convaincre, le jour de la Saint-Barthélémy et à quelques jours du mariage de sa sœur Marguerite et d'Henri de Navarre, de décréter le massacre général des protestants réformés de France. Premier chapitre. Violence absolue de l'homme seul, que l'on presse de toutes parts à prendre une décision à laquelle il se refuse, qui le heurte profondément. Saoulé de pressions, de mensonges, de quolibets, il craque. Se soumet. Il ne s'en remettra jamais. Un chapitre sérieux, dur, qui montre que la charge de roi n'était probablement pas pour lui. Tous les autres chapitres sont les tableaux de sa lente descente dans la folie, puis dans la mort.
Tous ses efforts pour se réconcilier avec son peuple vont être d'incroyables et piteux échecs.
Le déplacement de la date de début d'année, du printemps au 1er janvier, qui occasionne des milliers de morts chez les Français qui pour la fête, se parent de leurs habits printaniers un jour de neige et de froid dans tout le pays.
Le choix de faire distribuer des brins de muguet porte bonheur aux familles du royaume, le 1er mai. Dans un pays ravagé par la famine, des milliers d'enfants, d'hommes et de femmes meurent d'avoir mangé ce poison violent.
Et que dire de ses tentatives de renflouer le royaume en payant un alchimiste véreux, ou en fabriquant de la monnaie en bois...
Bref, j'ai été happé par ton roman qui raconte, à ta manière, dans un langage hybride qui touche juste, une histoire de France décalée, où l'anecdote sert de toile où tu traces le portrait d'un gamin qui se révèle incapable d'enrayer la spirale mortifère dans laquelle il est entré.
C'est un beau livre, tendre, drôle et triste. Ca ne m'a beaucoup étonné en vérité, je te le dis. Mais j'ai beaucoup aimé. Merci Teulé.
Amicalement, Hrundy V.
J'ai l'impression de te connaître depuis toujours.
Je recommence. En réalité, je te connais depuis toujours. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression diffuse que tu as foutu ta grande carcasse dans RécréA2 à un moment ou à un autre. Il y a eu bien sûr l'Echo, et Nulle part Ailleurs. Ta voix, je la connais. Ton style, je le connais. Ta gueule aussi je la connais, et c'est pas que parce que ton pote Edika te met en scène une eux fois dans Fluide. Y a autre chose. Je trouverai, nom de Zeus, je trouverai.
Tes mots en revanche, je les ai découverts tard, il y a une dizaine d'année, avec Rainbow pour Rimbaud, une belle histoire d'amour décalée qui part de Charleville-Mézières pour faire le tour du monde... Ton Je, François Villon était clair, simple, brillant et horrifiant. Je l'avais adoré, il m'avait dévoré.
Et puis cet été, puisque je me suis remis à lire, je me suis très naturellement plongé dans Charly 9, sans savoir dans quoi je m'aventurais.
Il est rassurant de se rendre compte que certaines bonnes choses ne changent pas. Ton style, fluide, rapide, agréable. Tes chapitres courts et nerveux. Tes dialogues, parfaitement huilés. L'humanité de tes personnages, surtout, leur ombre et leur lumière mélangées sans que jamais le flou ne s'installe. Et pourtant ça part sévère.
Premier chapitre, Catherine de Médicis sa mère, le duc d'Anjou son frère et l'ensemble de son conseil se liguent pour le convaincre, le jour de la Saint-Barthélémy et à quelques jours du mariage de sa sœur Marguerite et d'Henri de Navarre, de décréter le massacre général des protestants réformés de France. Premier chapitre. Violence absolue de l'homme seul, que l'on presse de toutes parts à prendre une décision à laquelle il se refuse, qui le heurte profondément. Saoulé de pressions, de mensonges, de quolibets, il craque. Se soumet. Il ne s'en remettra jamais. Un chapitre sérieux, dur, qui montre que la charge de roi n'était probablement pas pour lui. Tous les autres chapitres sont les tableaux de sa lente descente dans la folie, puis dans la mort.
Tous ses efforts pour se réconcilier avec son peuple vont être d'incroyables et piteux échecs.
Le déplacement de la date de début d'année, du printemps au 1er janvier, qui occasionne des milliers de morts chez les Français qui pour la fête, se parent de leurs habits printaniers un jour de neige et de froid dans tout le pays.
Le choix de faire distribuer des brins de muguet porte bonheur aux familles du royaume, le 1er mai. Dans un pays ravagé par la famine, des milliers d'enfants, d'hommes et de femmes meurent d'avoir mangé ce poison violent.
Et que dire de ses tentatives de renflouer le royaume en payant un alchimiste véreux, ou en fabriquant de la monnaie en bois...
Bref, j'ai été happé par ton roman qui raconte, à ta manière, dans un langage hybride qui touche juste, une histoire de France décalée, où l'anecdote sert de toile où tu traces le portrait d'un gamin qui se révèle incapable d'enrayer la spirale mortifère dans laquelle il est entré.
C'est un beau livre, tendre, drôle et triste. Ca ne m'a beaucoup étonné en vérité, je te le dis. Mais j'ai beaucoup aimé. Merci Teulé.
Amicalement, Hrundy V.
Libellés :
Catherine de Médicis,
Charles IX,
duc d'Anjou,
Edika,
Henri III,
Herni IV,
Jean Teulé,
littérature,
Marguerite de Valois,
Rimbaud,
roman,
Villon
vendredi 13 septembre 2013
Breakfast on the mornig tram
Chère Stacey,
Ca commence avec un piano solitaire. Un piano clair et frais qui tinte, même dans des sons pas si aigus. Il est bientôt rejoint par une batterie et un triangle. Dehors, le ciel est bleu, très clair très pâle comme un matin d'hiver. Un frisson me parcourt et je me demande comment j'ai fait pour me passer de l'hiver.
Il fait très froid depuis quelques jours, la faute à un Mistral des familles qui glace jusqu'au plus profond des os. En septembre, ça fait plutôt bizarre de ressortir les couettes et de se dire qu'il est temps de ressortir les couettes.
Desproges que ton album est un album d'hiver, Stacey ! Du Ice Hotel carillonnant jusqu'au What a wonderful world paisible et léger, j'ai envie de me projeter de quelques mois dans le temps et de me retrouver au petit matin, dehors, emmitouflé jusqu'au nez, un bon gros mug rempli de café bouillant entre les mains. Je me souviens d'un chalet dans une bourgade au-dessus de Gap, le Carpe Diem, où ton album aurait été parfait, accompagnant un moment de tendresse et de poésie au lever de la brume avec ma douce.
Tous les morceaux, même tes sambas, même le I wish I could go travelling again qui parle d'été, tout en cet album respire la douceur, la clarté, la la légèreté et la fraîcheur d'un matin ensoleillé d'hiver. Tes reprises en Français de Gainsbourg sont délicieusement suaves et ton jazz accessible, facile, paisible.
Je suis moi-même étonné par la quiétude que me procure ta voix. Agneau de Gainsbourg qui enlève la violence du monde, tu as pris pitié de moi... On redécouvre à chaque saison des albums qu'on croyait connaître par cœur. Je crois que ce week-end, je vais ramoner.
Merci Stacey.
Amicalement,
Hrundy V.
Ca commence avec un piano solitaire. Un piano clair et frais qui tinte, même dans des sons pas si aigus. Il est bientôt rejoint par une batterie et un triangle. Dehors, le ciel est bleu, très clair très pâle comme un matin d'hiver. Un frisson me parcourt et je me demande comment j'ai fait pour me passer de l'hiver.
Il fait très froid depuis quelques jours, la faute à un Mistral des familles qui glace jusqu'au plus profond des os. En septembre, ça fait plutôt bizarre de ressortir les couettes et de se dire qu'il est temps de ressortir les couettes.
Desproges que ton album est un album d'hiver, Stacey ! Du Ice Hotel carillonnant jusqu'au What a wonderful world paisible et léger, j'ai envie de me projeter de quelques mois dans le temps et de me retrouver au petit matin, dehors, emmitouflé jusqu'au nez, un bon gros mug rempli de café bouillant entre les mains. Je me souviens d'un chalet dans une bourgade au-dessus de Gap, le Carpe Diem, où ton album aurait été parfait, accompagnant un moment de tendresse et de poésie au lever de la brume avec ma douce.
Tous les morceaux, même tes sambas, même le I wish I could go travelling again qui parle d'été, tout en cet album respire la douceur, la clarté, la la légèreté et la fraîcheur d'un matin ensoleillé d'hiver. Tes reprises en Français de Gainsbourg sont délicieusement suaves et ton jazz accessible, facile, paisible.
Je suis moi-même étonné par la quiétude que me procure ta voix. Agneau de Gainsbourg qui enlève la violence du monde, tu as pris pitié de moi... On redécouvre à chaque saison des albums qu'on croyait connaître par cœur. Je crois que ce week-end, je vais ramoner.
Merci Stacey.
Amicalement,
Hrundy V.
vendredi 6 septembre 2013
Moravagine
Cher Blaise,
C'est incroyable comme on peut perdre un souvenir, oublier, faire une croix sans même y penser et puis paf ! un jour, ce souvenir revient à la surface, vivant, brûlant même et se rappelle à toi comme un vieil ami. Comme si tu te retrouvais avec un vieux pote au téléphone, que tu n'aurais plus vu depuis des années, et avec lequel tu terminerais la conversation entamée alors.
Ca m'arrive en ce moment, assez régulièrement, et ça m'est arrivé particulièrement avec l'une de tes œuvres, lue il y a une bonne dizaine d'année, à l'époque où ma seule consommation de livres et de BD faisait vivre grassement plusieurs familles de bucherons canadiens.
Je veux parler de Moravagine. Ce livre était complètent sorti de mon esprit et il m'a ressauté à la gueule il y a quelques jours, en lisant chez les inrocks un article sur les livres conseillés pour l'été par des écrivains, en l'occurrence Marie Darrieussecq. "Un roman que je ne comprends pas bien, alors je le relis souvent. Ce n’est pas mon roman préféré mais c’est celui auquel je reviens sans cesse, abasourdie". Abasourdi, c'est bien le mot.
Moravagine, allez, tu peux nous l'avouer, est une espèce d'autofiction où tu te mets en scène dans la peau d'un jeune médecin de tes amis, qui tombe sous le charme d'un descendant de la famille royale de Hongrie, aristocrate malade, dépravé et maniaque. On est mal à l'aise devant la bienveillance complice du narrateur alors que cet homme est un meurtrier récidiviste, exceptionnellement dangereux. L'intérêt clinique de départ se change en amitié puis en fascination, au point que Raymond la Science, le médecin, devient le complice de toutes les extravagances, happé dans une vie trépidante et aventureuse, mais aussi des folies, des exactions et des meurtres sauvages de Moravagine.
Voilà bien un roman qui te frappe au ventre. La tête te tourne, tes yeux se brouillent, ton esprit s'embrume. Tu ressors hébété de la lecture. D'Allemagne en Russie, jusqu'en Amérique les aventures se succèdent et se terminent presque à chaque fois en drames sanglants. Mais ce qui est certainement le plus dérangeant dans ce roman, outre encore une fois cette horrible rédaction à la première personne qui fait de nous tes complices, c'est le style.
Construit, carré, clinique, propre et sans accroc, académique, c'est une réelle façade que ton ami Raymond veut nous peindre. On se demande à chaque ligne où est la neutralité que tu sembles vouloir nous faire accroire. Ou plutôt : où s'arrête l'observation, où commence la complicité ? Bien avant de te lire, j'avais vu et vécu comme un autre coup à l'estomac l'ovni C'est arrivé près de chez vous, où la jeune équipe du cinéaste, Rémy, suit le tueur en série Benoît Poelvoorde pour se retrouver finalement embrigadée dans ses mésaventures...
Mais on n'arrive pas, dans C'est arrivé, à la connivence qui existe entre Moravagine et Raymond, qui fait naturellement penser au couple que forment Watson et Holmes. Et je me demande comment j'avais fait pour oublier cette histoire. Comment peut-on oublier cela ? Je me sens encore tout chose au simple fait d'y avoir repensé. En tout cas, voilà un sacré motif d'étonnement, et surtout un très, très grand moment.
Merci Blaise.
Amicalement,
Hrundy V.
C'est incroyable comme on peut perdre un souvenir, oublier, faire une croix sans même y penser et puis paf ! un jour, ce souvenir revient à la surface, vivant, brûlant même et se rappelle à toi comme un vieil ami. Comme si tu te retrouvais avec un vieux pote au téléphone, que tu n'aurais plus vu depuis des années, et avec lequel tu terminerais la conversation entamée alors.
Ca m'arrive en ce moment, assez régulièrement, et ça m'est arrivé particulièrement avec l'une de tes œuvres, lue il y a une bonne dizaine d'année, à l'époque où ma seule consommation de livres et de BD faisait vivre grassement plusieurs familles de bucherons canadiens.
Je veux parler de Moravagine. Ce livre était complètent sorti de mon esprit et il m'a ressauté à la gueule il y a quelques jours, en lisant chez les inrocks un article sur les livres conseillés pour l'été par des écrivains, en l'occurrence Marie Darrieussecq. "Un roman que je ne comprends pas bien, alors je le relis souvent. Ce n’est pas mon roman préféré mais c’est celui auquel je reviens sans cesse, abasourdie". Abasourdi, c'est bien le mot.
Moravagine, allez, tu peux nous l'avouer, est une espèce d'autofiction où tu te mets en scène dans la peau d'un jeune médecin de tes amis, qui tombe sous le charme d'un descendant de la famille royale de Hongrie, aristocrate malade, dépravé et maniaque. On est mal à l'aise devant la bienveillance complice du narrateur alors que cet homme est un meurtrier récidiviste, exceptionnellement dangereux. L'intérêt clinique de départ se change en amitié puis en fascination, au point que Raymond la Science, le médecin, devient le complice de toutes les extravagances, happé dans une vie trépidante et aventureuse, mais aussi des folies, des exactions et des meurtres sauvages de Moravagine.
Voilà bien un roman qui te frappe au ventre. La tête te tourne, tes yeux se brouillent, ton esprit s'embrume. Tu ressors hébété de la lecture. D'Allemagne en Russie, jusqu'en Amérique les aventures se succèdent et se terminent presque à chaque fois en drames sanglants. Mais ce qui est certainement le plus dérangeant dans ce roman, outre encore une fois cette horrible rédaction à la première personne qui fait de nous tes complices, c'est le style.
Construit, carré, clinique, propre et sans accroc, académique, c'est une réelle façade que ton ami Raymond veut nous peindre. On se demande à chaque ligne où est la neutralité que tu sembles vouloir nous faire accroire. Ou plutôt : où s'arrête l'observation, où commence la complicité ? Bien avant de te lire, j'avais vu et vécu comme un autre coup à l'estomac l'ovni C'est arrivé près de chez vous, où la jeune équipe du cinéaste, Rémy, suit le tueur en série Benoît Poelvoorde pour se retrouver finalement embrigadée dans ses mésaventures...
Mais on n'arrive pas, dans C'est arrivé, à la connivence qui existe entre Moravagine et Raymond, qui fait naturellement penser au couple que forment Watson et Holmes. Et je me demande comment j'avais fait pour oublier cette histoire. Comment peut-on oublier cela ? Je me sens encore tout chose au simple fait d'y avoir repensé. En tout cas, voilà un sacré motif d'étonnement, et surtout un très, très grand moment.
Merci Blaise.
Amicalement,
Hrundy V.
mercredi 4 septembre 2013
Un Palais à Orvieto
Chère Marlena,
Tu me vois assez ébaubi de ce qui est pour moi une découverte. Un palais à Orvieto a beau être ton 3e roman, assez autobiographique semble-t-il, la semaine dernière c'était la première fois que je te lisais. J'étais tombé par hasard sur ton livre, au petit bonheur d'une librairie méridionale, et j'avais été charmé par la quatrième de couverture, qui annonçait des alléchants paysages ombriens et des ripailles à n'en savoir plus que faire.
Fines et recherchées les ripailles, puisque tu es un chef. Américain, le chef, ce qui fait dire à l'un de tes personnages que tu ne peux pas savoir cuisiner puisque, américaine, tu ne sais faire que des hamburgers et des hot-dogs.
Or donc, me voilà étonné et charmé. Bien sûr il y a un petit air de déjà-vu chez toi, celui du britton Peter Mayle et de son Année en Provence, ancien et pourtant toujours si agréable à (re)lire. Mais je me suis laissé tout de suite happer par ton rythme, mélangeant agréablement le Français (très bien traduit) et l'Italien (pas toujours très heureusement traduit).
J'ai adoré ta façon de parler des gens, des produits, des recettes et de très peu évoquer les paysages, l'environnement, pour laisser l'imagination du lecteur (ni mon semblable ni mon frère mais en l'occurrence, moi) vagabonder et créer des paradis artificiels, peuplés d'oliviers, de vieilles pierres et de cyprès immenses.
Bref, c'est ton rapport à l'autre qui m'a intéressé. A ton mari, vénitien, à ces italiens du centre, ni nordistes au profil plus suisse, ni du sud au profil clairement méditerranéen, à tous ces gens qui ont tous quelque chose de spécial, quelquefois même extraordinaire. J'ai ri à tes questionnements féminins et tes réactions ébahies face aux petites cachotteries, aux jeux de pouvoir auxquels se livrent TOUS les italiens, en dignes successeurs de Machiavel, jusqu'à l'achat de fringue que tu dépeins en une sorte de guerre des nerfs jouissive pour ton lecteur, hallucinante et incompréhensible pour toi.
Cette insécurité dans les relations qu'en tant qu'américaine tu ressens fait sourire le méridional que je suis. Ton roman parle donc des gens, de la bouffe, de cette table d'hôtes dont tu rêves et que finalement tu vas aider quelqu'un d'autre à ouvrir. De l'importance de la table, de ce qu'il y a dessus, mais surtout de qui il y a autour pour rendre heureux.
Un livre de partage, de plaisir, un livre philanthrope malgré tes angoisses. Bref, un livre de table de chevet, à lire sous une pâle lumière, soit de nuit l'été, soit un matin d'hiver. Dans les deux cas, on en ressort rempli, détendu et heureux. Enfin, moi en tout cas. Merci Marlena.
Amicalement, Hrundy V.
Tu me vois assez ébaubi de ce qui est pour moi une découverte. Un palais à Orvieto a beau être ton 3e roman, assez autobiographique semble-t-il, la semaine dernière c'était la première fois que je te lisais. J'étais tombé par hasard sur ton livre, au petit bonheur d'une librairie méridionale, et j'avais été charmé par la quatrième de couverture, qui annonçait des alléchants paysages ombriens et des ripailles à n'en savoir plus que faire.
Fines et recherchées les ripailles, puisque tu es un chef. Américain, le chef, ce qui fait dire à l'un de tes personnages que tu ne peux pas savoir cuisiner puisque, américaine, tu ne sais faire que des hamburgers et des hot-dogs.
Or donc, me voilà étonné et charmé. Bien sûr il y a un petit air de déjà-vu chez toi, celui du britton Peter Mayle et de son Année en Provence, ancien et pourtant toujours si agréable à (re)lire. Mais je me suis laissé tout de suite happer par ton rythme, mélangeant agréablement le Français (très bien traduit) et l'Italien (pas toujours très heureusement traduit).
J'ai adoré ta façon de parler des gens, des produits, des recettes et de très peu évoquer les paysages, l'environnement, pour laisser l'imagination du lecteur (ni mon semblable ni mon frère mais en l'occurrence, moi) vagabonder et créer des paradis artificiels, peuplés d'oliviers, de vieilles pierres et de cyprès immenses.
Bref, c'est ton rapport à l'autre qui m'a intéressé. A ton mari, vénitien, à ces italiens du centre, ni nordistes au profil plus suisse, ni du sud au profil clairement méditerranéen, à tous ces gens qui ont tous quelque chose de spécial, quelquefois même extraordinaire. J'ai ri à tes questionnements féminins et tes réactions ébahies face aux petites cachotteries, aux jeux de pouvoir auxquels se livrent TOUS les italiens, en dignes successeurs de Machiavel, jusqu'à l'achat de fringue que tu dépeins en une sorte de guerre des nerfs jouissive pour ton lecteur, hallucinante et incompréhensible pour toi.
Cette insécurité dans les relations qu'en tant qu'américaine tu ressens fait sourire le méridional que je suis. Ton roman parle donc des gens, de la bouffe, de cette table d'hôtes dont tu rêves et que finalement tu vas aider quelqu'un d'autre à ouvrir. De l'importance de la table, de ce qu'il y a dessus, mais surtout de qui il y a autour pour rendre heureux.
Un livre de partage, de plaisir, un livre philanthrope malgré tes angoisses. Bref, un livre de table de chevet, à lire sous une pâle lumière, soit de nuit l'été, soit un matin d'hiver. Dans les deux cas, on en ressort rempli, détendu et heureux. Enfin, moi en tout cas. Merci Marlena.
Amicalement, Hrundy V.
lundi 2 septembre 2013
La Petite marchande de prose (relecture)
Cher Daniel,
Quelque chose me turlupine. Voilà donc la deuxième fois que je lis ta Petite marchande de prose, et probablement pas la seconde. La première fois, je n'étais pas loin de penser que ta série de Malaussène commençait à s'essouffler, prélude à un bien moins bon Monsieur Malaussène qui était carrément un peu long.
Mais ce qui me questionne, vois-tu, c'est comment j'ai pu oublier, ou passer à côté de tous ces merveilleux à-côté de ton récit. Comme toi - te l'ai-je dit ? - j'aime les parenthèses, les pauses, les digressions dans le récit. Celui qui se laisse prendre à la pause ou à la digression en cours de lecture peut se sentir vraiment partie intégrante de l’œuvre. A la fois lecteur et acteur, grâce à la parenthèse ton interlocuteur peut se lover, se sentir aimé du texte.
L'histoire de la rencontre de Loussa de Casamance avec la reine Zabo est une merveilleuse parenthèse, aventurière, riche, intelligente. L'histoire d'amour, passionnelle et platonique entre ces deux que tout opposait est tendre et pétillante.
Les personnages, la présentation toujours aérienne, poétique que tu en fais, sont jouissifs. Je suis, je pense que ton succès y est dû en partie, je suis, probablement comme tous ceux qui te lisent et qui t'aiment (et qui ne sont, chaque fois, ni tout à la fait les mêmes ni tout à fait des autres...), je suis un enfant quand je te lis. Émerveillé des beautés du langage, des mots, de leurs sons, leurs images, leur rythmique. Par l'inventivité enchantée dont tu fais preuve. C'est donc toujours un bonheur de te lire.
En revanche, l'intrigue est moins riche, moins tarabiscotée, moins efficace que lors des deux premiers opus. Rapidement on a tous les éléments pour trouver les méchants, et c'est la raison pour laquelle j'avais été frustré à la première lecture. J'avais adoré, dans le Bonheur des Ogres comme dans la Fée Carabine, être baladé au gré de l'enquête, perdu dans les supputations, étonné par les rebondissements...
Foin de tout cela dans la Petite Marchande. Cousu de fil blanc. Disons gris pour être sympa, et respectueux de ta majestueuse pétillance. Mais vois-tu, maintenant que j'ai repense, ce qui avait agacé le primo-lecteur, impatient et avide de suspense que j'étais il y a une grosse dizaine d'années, ce qui m'avait agacé disais-je ne m'a pas posé de problème à la relecture. J'avais déjà lu le dénouement, et je ne pouvais pas être frustré par la facilité à le découvrir.
Non, j'ai pu déguster en gourmet prenant son temps les tours et les détours de la langue dont tu sers, cette langue riche mais accessible, imagée mais compréhensible, enchantée mais accrochée à la vie réelle. Du coup, je vais peut-être même relire le Dictateur et le Hamac, maintenant que je suis un lecteur sage et posé.
Je te remercie pour toutes ces étoiles que tu allumes dans mes yeux,
Amicalement,
Hrundy V.
Quelque chose me turlupine. Voilà donc la deuxième fois que je lis ta Petite marchande de prose, et probablement pas la seconde. La première fois, je n'étais pas loin de penser que ta série de Malaussène commençait à s'essouffler, prélude à un bien moins bon Monsieur Malaussène qui était carrément un peu long.
Mais ce qui me questionne, vois-tu, c'est comment j'ai pu oublier, ou passer à côté de tous ces merveilleux à-côté de ton récit. Comme toi - te l'ai-je dit ? - j'aime les parenthèses, les pauses, les digressions dans le récit. Celui qui se laisse prendre à la pause ou à la digression en cours de lecture peut se sentir vraiment partie intégrante de l’œuvre. A la fois lecteur et acteur, grâce à la parenthèse ton interlocuteur peut se lover, se sentir aimé du texte.
L'histoire de la rencontre de Loussa de Casamance avec la reine Zabo est une merveilleuse parenthèse, aventurière, riche, intelligente. L'histoire d'amour, passionnelle et platonique entre ces deux que tout opposait est tendre et pétillante.
Les personnages, la présentation toujours aérienne, poétique que tu en fais, sont jouissifs. Je suis, je pense que ton succès y est dû en partie, je suis, probablement comme tous ceux qui te lisent et qui t'aiment (et qui ne sont, chaque fois, ni tout à la fait les mêmes ni tout à fait des autres...), je suis un enfant quand je te lis. Émerveillé des beautés du langage, des mots, de leurs sons, leurs images, leur rythmique. Par l'inventivité enchantée dont tu fais preuve. C'est donc toujours un bonheur de te lire.
En revanche, l'intrigue est moins riche, moins tarabiscotée, moins efficace que lors des deux premiers opus. Rapidement on a tous les éléments pour trouver les méchants, et c'est la raison pour laquelle j'avais été frustré à la première lecture. J'avais adoré, dans le Bonheur des Ogres comme dans la Fée Carabine, être baladé au gré de l'enquête, perdu dans les supputations, étonné par les rebondissements...
Foin de tout cela dans la Petite Marchande. Cousu de fil blanc. Disons gris pour être sympa, et respectueux de ta majestueuse pétillance. Mais vois-tu, maintenant que j'ai repense, ce qui avait agacé le primo-lecteur, impatient et avide de suspense que j'étais il y a une grosse dizaine d'années, ce qui m'avait agacé disais-je ne m'a pas posé de problème à la relecture. J'avais déjà lu le dénouement, et je ne pouvais pas être frustré par la facilité à le découvrir.
Non, j'ai pu déguster en gourmet prenant son temps les tours et les détours de la langue dont tu sers, cette langue riche mais accessible, imagée mais compréhensible, enchantée mais accrochée à la vie réelle. Du coup, je vais peut-être même relire le Dictateur et le Hamac, maintenant que je suis un lecteur sage et posé.
Je te remercie pour toutes ces étoiles que tu allumes dans mes yeux,
Amicalement,
Hrundy V.
Inscription à :
Articles (Atom)